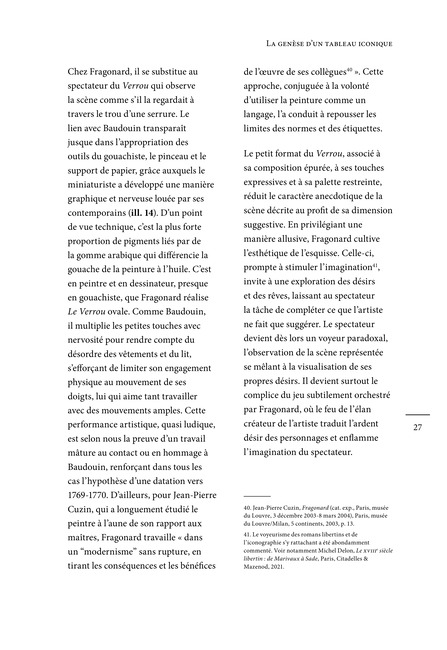Fragonard - Marguerite Gérard. Une révélation, des propositions. Exposition mars 2025 - Catalogue - Page 31

La gen,se d’un tableau iconique
Chez Fragonard, il se substitue au
spectateur du Verrou qui observe
la scène comme s’il la regardait à
travers le trou d’une serrure. Le
lien avec Baudouin transparaît
jusque dans l’appropriation des
outils du gouachiste, le pinceau et le
support de papier, grâce auxquels le
miniaturiste a développé une manière
graphique et nerveuse louée par ses
contemporains (ill. 14). D’un point
de vue technique, c’est la plus forte
proportion de pigments liés par de
la gomme arabique qui différencie la
gouache de la peinture à l’huile. C’est
en peintre et en dessinateur, presque
en gouachiste, que Fragonard réalise
Le Verrou ovale. Comme Baudouin,
il multiplie les petites touches avec
nervosité pour rendre compte du
désordre des vêtements et du lit,
s’efforçant de limiter son engagement
physique au mouvement de ses
doigts, lui qui aime tant travailler
avec des mouvements amples. Cette
performance artistique, quasi ludique,
est selon nous la preuve d’un travail
mâture au contact ou en hommage à
Baudouin, renforçant dans tous les
cas l’hypothèse d’une datation vers
1769-1770. D’ailleurs, pour Jean-Pierre
Cuzin, qui a longuement étudié le
peintre à l’aune de son rapport aux
maîtres, Fragonard travaille « dans
un “modernisme” sans rupture, en
tirant les conséquences et les bénéfices
de l’œuvre de ses collègues40 ». Cette
approche, conjuguée à la volonté
d’utiliser la peinture comme un
langage, l’a conduit à repousser les
limites des normes et des étiquettes.
Le petit format du Verrou, associé à
sa composition épurée, à ses touches
expressives et à sa palette restreinte,
réduit le caractère anecdotique de la
scène décrite au profit de sa dimension
suggestive. En privilégiant une
manière allusive, Fragonard cultive
l’esthétique de l’esquisse. Celle-ci,
prompte à stimuler l’imagination41,
invite à une exploration des désirs
et des rêves, laissant au spectateur
la tâche de compléter ce que l’artiste
ne fait que suggérer. Le spectateur
devient dès lors un voyeur paradoxal,
l’observation de la scène représentée
se mêlant à la visualisation de ses
propres désirs. Il devient surtout le
complice du jeu subtilement orchestré
par Fragonard, où le feu de l’élan
créateur de l’artiste traduit l’ardent
désir des personnages et enflamme
l’imagination du spectateur.
40. Jean-Pierre Cuzin, Fragonard (cat. exp., Paris, musée
du Louvre, 3 décembre 2003-8 mars 2004), Paris, musée
du Louvre/Milan, 5 continents, 2003, p. 13.
41. Le voyeurisme des romans libertins et de
l’iconographie s’y rattachant a été abondamment
commenté. Voir notamment Michel Delon, Le xviiie siècle
libertin : de Marivaux à Sade, Paris, Citadelles &
Mazenod, 2021.
27